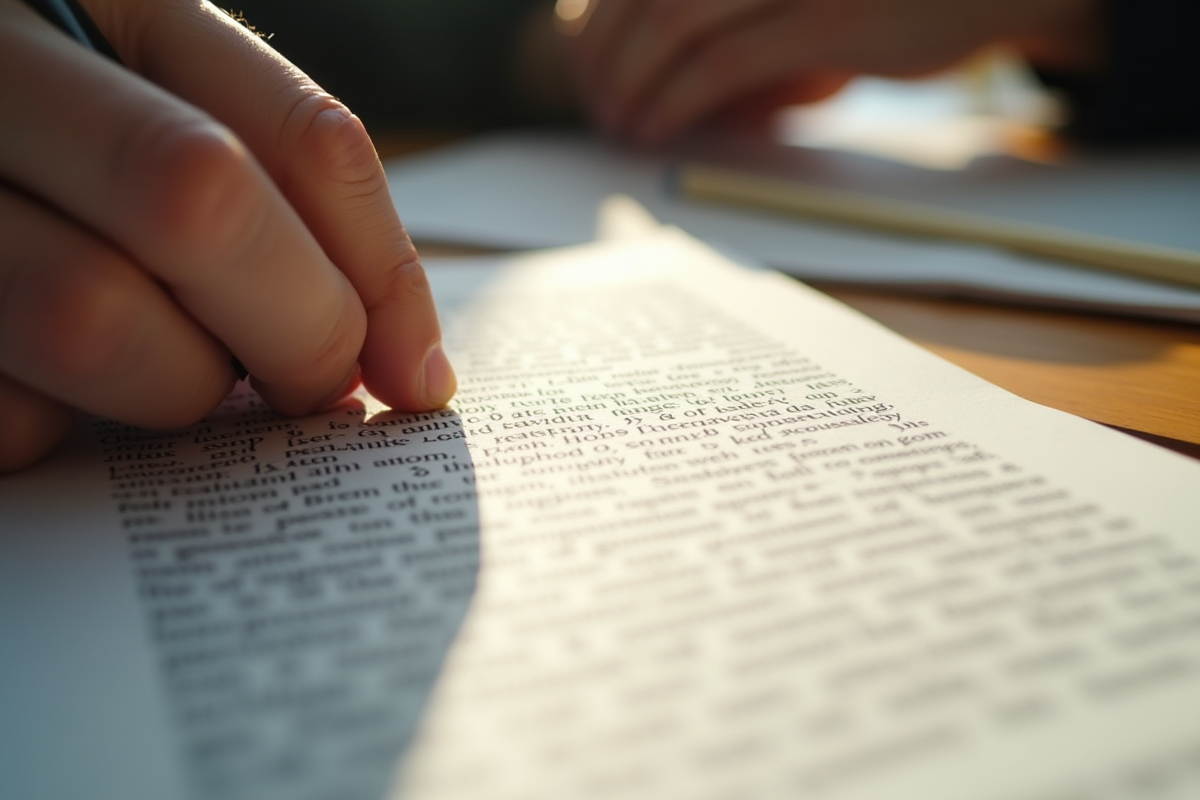Depuis 2020, l’introduction d’une action devant certaines juridictions civiles impose une tentative préalable de résolution amiable du litige. L’article 750-1 du Code de procédure civile encadre strictement cette exigence et prévoit des sanctions en cas de non-respect, dont l’irrecevabilité de la demande.
Des exceptions limitativement énumérées permettent toutefois d’échapper à cette obligation, mais leur interprétation suscite régulièrement des débats. La question de la preuve de la tentative amiable, souvent négligée, devient ainsi un point de vigilance essentiel pour les praticiens comme pour les justiciables.
Pourquoi l’article 750-1 du Code de procédure civile change la donne dans les litiges civils
L’article 750-1 du code de procédure civile ne fait pas que modifier la procédure : il impose un nouveau réflexe aux justiciables comme à leurs conseils. Ce texte, né d’un décret et adossé à la loi, conditionne la recevabilité d’une demande en justice à la réalisation d’une tentative amiable dans certains litiges civils. Désormais, la justice intervient en dernier recours, et non plus comme première étape.
Le conseil d’état a validé ce dispositif, au nom de l’efficacité et de la volonté de désengorger les tribunaux. Dans les faits, la mise en œuvre de cette mesure bouleverse la gestion quotidienne des contentieux : avocats et parties n’ont plus d’autre choix que de justifier concrètement d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, selon les modalités prévues. La procédure civile se transforme, imposant aux acteurs de prouver leur volonté réelle de trouver un terrain d’entente avant de saisir le juge.
Voici ce que cela implique concrètement :
- La tentative amiable s’impose comme une séquence incontournable, bousculant le calendrier et l’esprit même de la procédure.
- Ce préalable modifie la relation au juge, qui ne devient accessible qu’après épuisement du dialogue.
- La question de la preuve et de la traçabilité des démarches amiables occupe désormais une place centrale, tant pour les parties que pour leurs représentants.
Ce texte ne se limite donc pas à une simple étape formelle. Il interpelle sur la fonction même de la justice et sur l’obligation, pour chacun, de tenter une résolution amiable avant de recourir à la voie contentieuse. Le code ne se contente plus de réguler l’affrontement, il fait de la négociation un passage obligé.
Quels litiges sont concernés par la tentative amiable obligatoire ?
La tentative amiable avant saisine du juge concerne une large palette de litiges civils, tels que définis par le code de procédure civile. L’article 750-1 s’applique notamment aux affaires portant sur des créances ou des questions de propriété lorsque le montant en jeu ne dépasse pas 5 000 euros. Mais ce n’est pas tout. Les troubles anormaux de voisinage sont également visés, tout comme de nombreux différends du quotidien : conflits de consommation, désaccords entre particuliers, litiges de copropriété ou de recouvrement de petites sommes.
Toutefois, le législateur a prévu plusieurs exceptions précises. Lorsque l’urgence s’impose, il reste possible de saisir le juge sans passer par une démarche amiable préalable. Même chose si une mesure provisoire ou conservatoire doit être ordonnée rapidement, ou si le contact avec l’autre partie est objectivement impossible. Enfin, si une conciliation, une médiation ou une procédure participative a déjà échoué sur le même litige, la tentative amiable n’est plus exigée.
Pour mieux cerner ces situations, voici les principaux cas concernés :
- Actions portant sur des montants inférieurs ou égaux à 5 000 euros
- Litiges de voisinage, en particulier pour trouble anormal
- Procédure simplifiée de recouvrement de créances
- Affaires bénéficiant d’exceptions expressément prévues par le code
La procédure civile instaure ainsi un filtre amiable pour une grande majorité des affaires courantes, tout en préservant la possibilité de saisir directement le juge lorsque la situation l’impose.
Étapes clés : comment se déroule une tentative amiable selon le 750-1 CPC
La tentative préalable de résolution amiable s’inscrit désormais comme une condition à remplir avant d’engager bien des contentieux civils. Le demandeur doit activer un mode amiable avant toute action judiciaire. Trois options s’offrent à lui : conciliation, médiation ou procédure participative. Chacune obéit à des règles précises.
Concrètement, tout commence par une prise de contact officielle, suivie d’une rencontre, souvent organisée par un conciliateur de justice ou un médiateur agréé. L’objectif : rapprocher les points de vue, tenter un compromis. Mais la réussite n’est jamais garantie. Si aucun accord n’est trouvé, le demandeur doit prouver qu’il a bien accompli toutes les démarches requises. Cela passe par un document justificatif : attestation de carence, procès-verbal de non-conciliation, certificat délivré par le professionnel sollicité. Sans cette pièce, la sanction est immédiate : irrecevabilité de la demande en justice. Le juge ne statue même pas sur le fond.
À noter : la prescription se trouve suspendue pendant la médiation ou la conciliation, ce qui protège les droits du justiciable durant toute cette phase. Chaque étape s’inscrit dans un calendrier strict, encadré par le code. Ne pas respecter ces règles expose à un rejet de la procédure dès le début.
L’accompagnement par un professionnel du droit, une aide précieuse pour réussir sa démarche
Dialoguer, négocier, formaliser : trois moments clés, mais un parcours loin d’être évident, même pour les personnes averties. Que ce soit par procédure participative ou par médiation, avancer demande de la méthode et une solide préparation. Dans cet univers, l’appui d’un professionnel du droit change la donne. Avocat, médiateur ou conciliateur de justice : chacun intervient à une étape déterminée. L’avocat apporte sa vision stratégique, analyse la nature du conflit et sait quel document produira ses effets. Le médiateur ouvre le dialogue, veille à la neutralité du cadre, aide à bâtir un compromis. Le conciliateur de justice, bénévole assermenté, intervient surtout dans les litiges du quotidien, notamment en voisinage ou pour des créances civiles.
Pour mieux comprendre l’apport de chaque intervenant, voici leurs forces respectives :
- Expertise juridique : l’avocat connaît parfaitement la procédure participative, anticipe les points de blocage, rédige les conventions nécessaires.
- Médiation : un médiateur agréé par la cour d’appel (que ce soit à Nîmes, Lyon ou ailleurs) garantit neutralité et confidentialité.
- Conciliation : le conciliateur de justice intervient gratuitement, et produit un procès-verbal en cas d’accord, document indispensable devant le juge.
La cour d’appel veille à la compétence des intervenants et au respect des procédures. Les parties, qu’elles soient assistées ou représentées, avancent dans un cadre où chaque mot pèse. Le tiers amiable compositeur, avocat, médiateur, conciliateur, devient ainsi le garant du bon déroulement de la démarche, sécurise la procédure et veille à la préservation des droits de chacun.
Choisir le bon interlocuteur, c’est s’assurer de franchir le filtre du 750-1 CPC et, le cas échéant, d’accéder à la justice du fond. Rester attentif à cette étape, c’est éviter que la porte du tribunal ne se referme avant même d’avoir pu exposer sa cause.