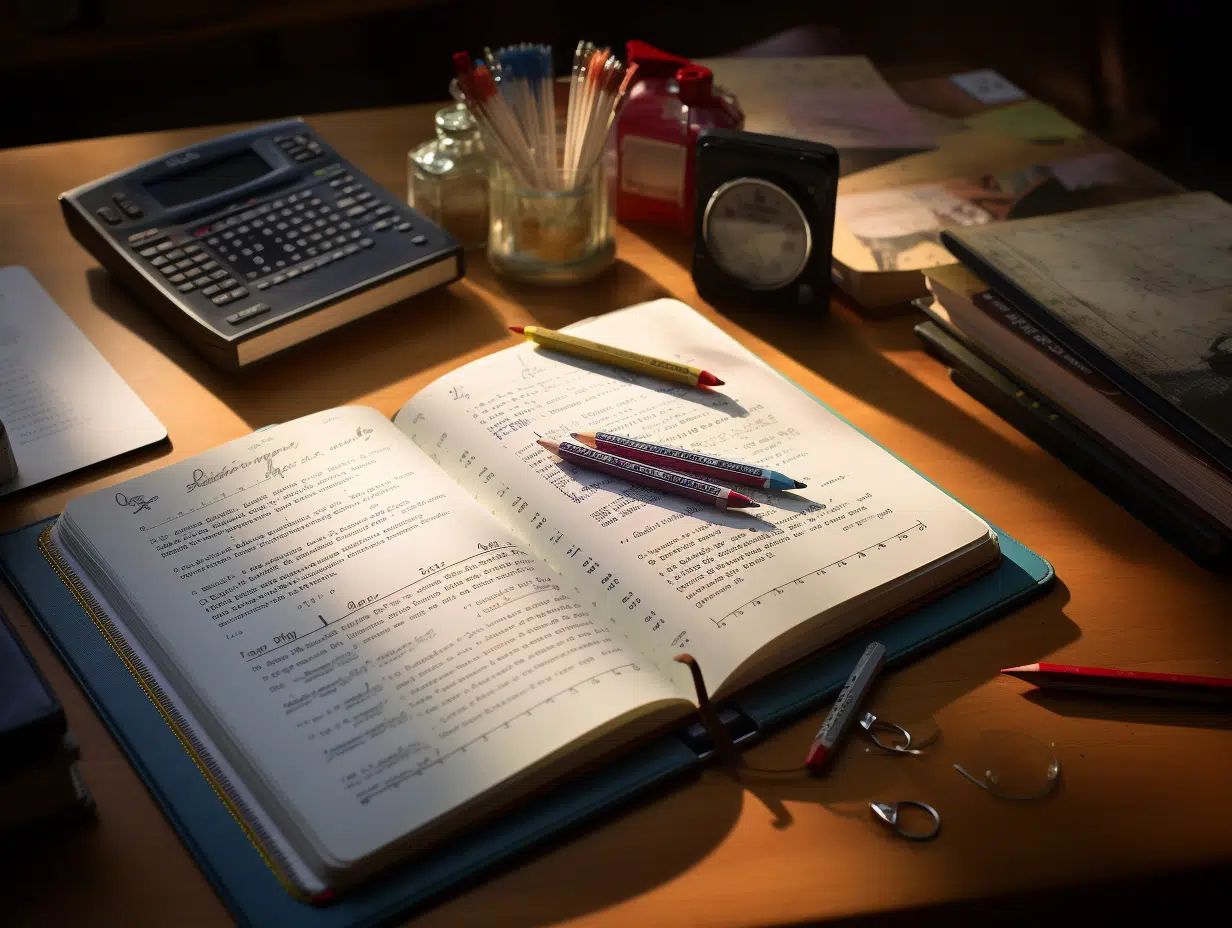L’écart entre M1 et M2 varie fortement selon les pays, sans lien direct avec la taille de leur économie. Certaines institutions financières réservent le terme de monnaie à M1, alors que d’autres incluent systématiquement M2 dans leurs analyses. Les autorités monétaires ajustent parfois la composition de ces agrégats, provoquant des révisions rétroactives des statistiques.
Au fil des années, la méthode de calcul de M1 et M2 s’est affinée pour répondre à la diversité des instruments financiers et à l’évolution des pratiques bancaires. Comprendre les étapes précises de ce calcul permet d’éviter les confusions fréquentes et d’interpréter correctement les résultats.
Pourquoi distinguer M1 et M2 change la compréhension de la masse monétaire
Séparer M1 et M2 n’est pas un caprice d’économiste : c’est un choix structurant pour toute analyse de la masse monétaire. Cette distinction guide les décisions majeures des banques centrales. M1, c’est la monnaie en action : pièces, billets, dépôts à vue, chèques de voyage. La liquidité à l’état pur, celle qui circule dans les paiements quotidiens, sans délai ni détour.
M2, lui, va plus loin. Il englobe tout M1, y ajoute les dépôts d’épargne, les fonds du marché monétaire, les certificats de dépôt. La Federal Reserve Bank ne laisse rien au hasard : chaque semaine, elle publie des chiffres précis, classés par degré de liquidité. Cette finesse d’analyse permet d’observer, quasiment en temps réel, le pouls de la monnaie.
Mais l’impact de M1 et M2 ne s’arrête pas aux statistiques. Ces agrégats sont les outils de pilotage des banques commerciales pour anticiper la demande de crédit, jauger la confiance des épargnants ou mesurer la capacité de l’économie à encaisser un choc. La banque centrale européenne ou la Fed modulent leurs taux, ajustent leur politique monétaire et fixent le cap pour l’inflation, la croissance économique ou la stabilité des prix en s’appuyant sur ces repères.
Voici ce qui distingue nettement ces deux indicateurs :
- M1 capte la monnaie immédiatement accessible, pilier de la liquidité réelle.
- M2 étend cette base, en ajoutant les dépôts à terme et les instruments transformables rapidement.
- Les banques centrales réajustent leur stratégie au gré des évolutions de ces volumes.
Chaque fluctuation de M1 ou de M2 envoie un signal direct sur l’état du système bancaire et la marge de manœuvre des décideurs face aux crises. La publication régulière de M1 par la Federal Reserve n’est pas un simple rituel : c’est l’indicateur surveillé de près par tous les acteurs économiques.
À quoi correspondent concrètement les agrégats M1 et M2 ?
M1, c’est le noyau dur de la masse monétaire : la monnaie disponible sans délai pour régler, retirer, transférer. Sa définition tient en quelques mots : M1 regroupe les pièces et billets en circulation, les dépôts à vue et les chèques de voyage. Une base tangible, qui reflète la liquidité immédiatement utilisable dans l’économie. Pour les économistes, M1 représente la forme la plus resserrée et la plus mobile de la monnaie.
M2, pour sa part, élargit ce périmètre en englobant l’ensemble de M1 et en y ajoutant des supports à liquidité rapide mais non instantanée. On y retrouve notamment les dépôts d’épargne, les fonds du marché monétaire et les certificats de dépôt à court terme. Ces montants ne servent pas de monnaie au quotidien, mais peuvent basculer très vite en moyens de paiement. M2 mesure ainsi la capacité des banques à répondre à une brusque demande de retraits ou de crédit.
Pour clarifier la composition de chacun :
- M1 : pièces et billets en circulation, dépôts à vue, chèques de voyage
- M2 : M1 + dépôts d’épargne + fonds du marché monétaire + certificats de dépôt
Le calcul de ces agrégats s’appuie sur des données bancaires consolidées, qui alimentent non seulement la statistique, mais aussi les modèles de robustesse utilisés par les économistes. En février 2015, M1 franchissait la barre des 3 billions de dollars, tandis que M2 dépassait 11,8 billions. Un écart qui illustre concrètement la différence entre monnaie strictement liquide et masse monétaire élargie, fondement de toute analyse monétaire sérieuse.
Calcul étape par étape : méthode claire pour déterminer M1 et M2
M1 : le socle de la liquidité
Pour établir M1, il faut réunir trois catégories : pièces et billets en circulation, dépôts à vue et chèques de voyage. Additionnez ces montants, issus des relevés des établissements financiers. C’est sur cette base que la Federal Reserve Bank publie chaque jour le niveau de M1, reflet fidèle de la liquidité mobilisable à tout instant.
Voici les composants à intégrer dans votre calcul :
- Pièces et billets en circulation : montants physiques disponibles dans l’économie.
- Dépôts à vue : sommes placées sur les comptes courants, utilisables sans préavis.
- Chèques de voyage : titres assimilés à de la monnaie liquide, acceptés dans de nombreux paiements.
M2 : élargir la perspective monétaire
Pour déterminer M2, commencez par la valeur obtenue pour M1, puis ajoutez trois types de ressources : dépôts d’épargne, fonds du marché monétaire, certificats de dépôt à court terme. Ces sommes ne servent pas à régler directement des achats, mais peuvent être transformées en monnaie disponible en quelques jours. Aux États-Unis, la Federal Reserve Bank publie chaque semaine ces données, base de l’analyse des évolutions monétaires.
| Composants | M1 | M2 |
|---|---|---|
| Pièces et billets | ✔ | ✔ |
| Dépôts à vue | ✔ | ✔ |
| Chèques de voyage | ✔ | ✔ |
| Dépôts d’épargne | ✔ | |
| Fonds du marché monétaire | ✔ | |
| Certificats de dépôt | ✔ |
À chaque phase du calcul, un point reste incontournable : la fiabilité et la fraîcheur des données utilisées. Ce processus, loin d’être purement théorique, se révèle indispensable pour comprendre l’évolution de l’économie et la capacité du secteur bancaire à répondre aux défis de la liquidité.
Exemples pratiques et analyses : l’impact des calculs sur l’analyse financière
Lecture concrète des agrégats monétaires
Sur le terrain, M1 et M2 sont les repères quotidiens des acteurs bancaires. Les établissements financiers examinent de près ces indicateurs pour piloter la liquidité du marché et ajuster leur politique de crédit. Un M1 élevé signale une circulation massive de moyens de paiement immédiatement disponibles : pièces, billets, comptes courants. Les responsables de trésorerie s’appuient sur ce constat pour décider du volume des prêts ou du niveau des réserves.
Quelques situations illustrent l’utilité de ces chiffres :
- Une hausse rapide de M1 ouvre la voie à une plus grande consommation et à une dynamique d’investissement.
- Un écart large entre M1 et M2 indique que de nombreux capitaux sont immobilisés en produits d’épargne ou fonds du marché monétaire, donc moins disponibles à court terme.
Répercussions sur la politique monétaire et l’économie
La banque centrale garde ces agrégats à l’œil pour ajuster ses taux et réguler l’offre de monnaie. Un M2 qui grimpe beaucoup plus vite que la production, c’est le terrain propice à l’inflation. Si au contraire M2 se contracte, le crédit se resserre, avec des effets directs sur la croissance. Les statistiques publiées chaque semaine par la Federal Reserve Bank permettent aux analystes d’anticiper les tensions du marché monétaire, de juger la vitalité des circuits financiers et d’orienter les investissements.
Une analyse fine des flux monétaires éclaire la gestion des risques, la stabilité des prix et l’évolution du crédit. Les décisions, qu’il s’agisse d’un ajustement du taux directeur ou d’une nouvelle facilité de refinancement, découlent de cette lecture précise de la circulation de la monnaie. Observer M1 et M2, c’est saisir le tempo de l’économie, et parfois, entrevoir les turbulences à venir.